De la face cachée de la lune au soleil levant. L'exercice de comparaison à part entière
- Rosana Guber
- ― voir biodata
De la face cachée de la lune au soleil levant. L'exercice de comparaison à part entière
Réception : 7 janvier 2024
Acceptation : 9 janvier 2024
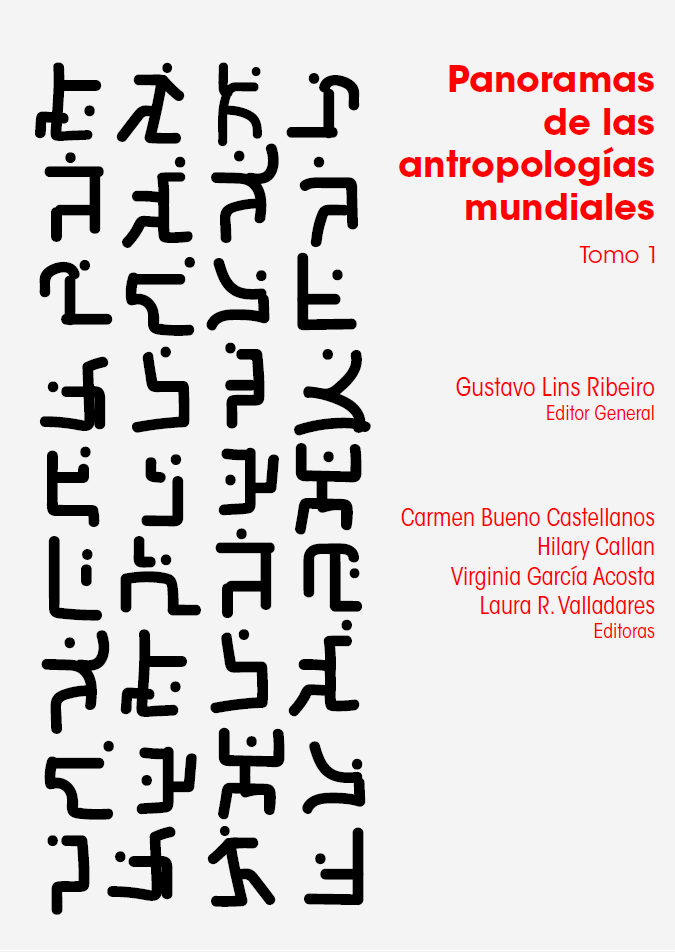
Panorama des anthropologies mondiales
Gustavo Lins Ribeiro (éd. Gral.), Carmen Bueno Castellanos, Hilary Callan, Virginia García Acosta et Laura R. Valladares (éd.)2023 CIESAS/UAM-I/UAM-L/ Universidad Iberoamericana, Mexique.
Les deux volumes qui composent cet ouvrage présentent, en espagnol, les contributions de 35 auteurs sur les anthropologies de leurs pays respectifs, ainsi qu'une introduction de l'éditeur brésilien Gustavo Lins Ribeiro et un chapitre sur l'approche "Anthropologies du monde" du Colombien Eduardo Restrepo. Le corps de l'ouvrage est constitué de 27 chapitres sur les nations, deux sur des régions politico-continentales (Afrique subsaharienne et Europe post-socialiste) et un sur une région sub-nationale (Sibérie), ainsi qu'un chapitre d'ouverture sur la place de la discipline à l'Unesco, institution mondiale s'il en est. Ces articles ont été rédigés par un certain nombre d'auteurs appelés il y a quelques années par Lins Ribeiro lui-même à composer le volet "Anthropologies du monde" de l'opus magnum d'Hilary Callan, le Encyclopédie internationale d'anthropologie, publié par Wiley & Sons en 2018. Tout au long de ses douze volumes, l'anthropologie des pays sélectionnés est entrecoupée, dans un ordre alphabétique strict, d'"entrées" thématiques concernant l'alimentation, l'économie, la politique, les arts et la religion, les conflits, l'anthropologie publique et une sélection minutieuse - également réalisée par Lins Ribeiro - appelée "Biographies", qui présente des collègues notables du monde entier : par exemple, le Brésilien Roberto Cardoso de Oliveira, l'Argentine Esther Hermitte, l'Indien Irawati Karve, le Sud-Africain Archie Mafeje, le Mexicain Angel Palerm, le Japonais Tadao Umesao, ainsi que les héros renommés de l'anthropologie de l'Atlantique Nord : Franz Boas, Max Gluckman, Edmund Leach, Claude Lévi-Strauss, Bronisław Malinowski, Marcel Mauss, Alfred R. Radcliffe-Brown, Victor et Edith Turner, de même que d'éminents spécialistes de l'anthropologie de l'Amérique du Nord. influenceurs (nous les appellerions ainsi aujourd'hui) de la pensée anthropologique, tels que Karl Marx, Friedrich Engels, Antonio Gramsci et même Emmanuel Kant et Adam Smith.
Grâce à la décision généreuse de Lins Ribeiro, Hilary Callan et des éditeurs Carmen Bueno Castellanos, Virginia García Acosta et Laura R. Valladares, nous nous trouvons face à une sélection qui, en espagnol, peut se transformer en une puissante centrale d'imagination anthropologique.1 Ceux d'entre nous qui se consacrent depuis longtemps à l'élucidation des particularités de nos anthropologies se sont limités à reconnaître les différences et les similitudes régionales et, plus ou moins implicitement, à contraster (et à coupler) leur travail avec les anthropologies métropolitaines : aujourd'hui, les anthropologies nord-américaine, française et britannique ; il y a un siècle, les anthropologies germanophone et italophone. Et malgré le fait que, pendant une bonne partie du 20e siècle, l xxiAlors que nous montrons des signes d'avoir commencé à comprendre que les anthropologies que nous appelons "classiques" sont, à leur tour, des réponses locales et nationales à des processus historiques, politiques et sociaux, ceux d'entre nous qui font, pensent, écrivent et enseignent l'anthropologie à partir du "reste du monde" se sont obstinément considérés comme la face cachée de la lune.
Cependant, le passage des entrées disséminées dans les 12 volumes de la EncyclopédieLe fait que nous ayons quelques volumes, avec leurs différents thèmes par ordre alphabétique, dans seulement quelques volumes dans lesquels nos anthropologies réelles existantes sont discriminées l'une après l'autre, et dans leur propre droit, n'est pas anodin. Il en résulte un produit qui peut être abordé sous différents angles et dimensions. Je me propose, dans ces quelques pages, d'avancer une approche proprement anthropologique de ce travail, c'est-à-dire respectant le paradoxe fondateur de notre discipline : la diversité dans l'unité du genre humain... et de ses anthropologies.
Tout d'abord, les rédacteurs de Panoramas... ont regroupé les entrées par région du monde (Asie et Océanie), par continent (Afrique, Amériques) et par sous-continent (Europe occidentale, Europe de l'Est, Scandinavie). À l'intérieur, ils ont classé par ordre alphabétique chacune des sections nationales (Argentine, Brésil...). Ils ont également transformé ces entrées de l'anglais vers l'espagnol.2 Ce matériel, divisé en chapitres qui se succèdent, met à la disposition de ceux d'entre nous qui lisent, parlent et pensent en espagnol, une sorte de "tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'anthropologie d'ailleurs". Comme s'il s'agissait d'un musée, de ses vitrines colorées où tout semble à portée de main, même les choses les plus étranges. Une palette de peintre. Une vitrine intéressante, une boîte à outils ?
L'un des premiers effets de la lecture de la collection et de la traduction de textes écrits en anglais sur des anthropologies qui nous sont exotiques est précisément la proximité, l'entrée de ces anthropologies sur notre table quotidienne ou, plus concrètement, sur le menu du possible : poulet, pâtes, mais aussi riz, porc, taro, haricots, pain et chocolat. Peut-être un nouveau pas qui nous permet de relativiser l'idée que la mondialisation ne peut s'écrire et se comprendre qu'en anglais, comme l'a fait la Commission européenne. La mondialisation.
Au fil des chapitres, le lecteur constatera que l'anthropologie est née, a été, est et, semble-t-il, continuera d'être une discipline éminemment mondiale. Les colonialismes ont été les berceaux d'une discipline faite pour penser et étudier l'humanité à travers ses différences sauvages (donc indomptées, persistantes, rebelles, toujours menaçantes...). Ainsi, ceux d'entre nous qui ont pratiqué l'anthropologie ont généré des discours de ce que Lins Ribeiro a appelé la "cosmopolitique". L'"Introduction" et le chapitre de Restrepo avec le chapitre de Nuria Sanz sur l'anthropologie à l'Unesco présentent quelques réflexions à ce sujet. Mais, en outre, cette cosmopolitique se retrouve dans chacun des chapitres, aussi bien dans les chapitres régionaux et d'époque que dans le chapitre subnational sur la Sibérie et ceux qui sont strictement circonscrits aux États-nations. "L'unité du genre anthropologique" a différentes façons de s'exprimer et de se reconnaître. Il y a les routes de la colonisation, outre-mer et "ultra-terrestre" (vers les steppes sibériennes ou vers l'ouest de la vaste Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud amazonienne). Il y a les problèmes que ces routes rendent viables et dénoncent, comme la traite des esclaves, le travail sous contrat (travail sous contrat) et les migrations des peuples à travers la Méditerranée, l'Amérique centrale et le Mexique, les réfugiés du Proche-Orient et les migrants missionnaires vers les terres promises. Il y a les traditions nominatives qui circulent en tant que l'ethnologie, ethnologie, la Volkskunde et le Volkerkundefolklore et Anthropologie culturelle, entre autres. Il y a aussi les transits d'auteurs de collègues qui migrent de façon permanente ou temporaire, comme Boas, Malinowski et Radcliffe-Brown vers les États-Unis. États-UnisLévi-Strauss au Brésil ou Johannes Fabian au Congo, et il y a ceux qui se déplacent à travers leurs œuvres.
Le monde est plus petit que l'effet hypnotique de ses diverses couleurs. La multiplicité des "entrées" dans ces 790 pages permet de découvrir, par leur contiguïté éditoriale, comment les anthropologies subsahariennes émergent dans les anthropologies latino-américaines (et vice versa), l'anthropologie soviétique dans l'anthropologie est-européenne et latino-américaine, l'anthropologie indienne dans l'anthropologie américaine et, surtout, les anthropologies euro-occidentales dans celles du "reste du monde". Cette perspective, relativement rare dans notre travail, il pourrait avoir un effet positif sur la qualité de la vie. Panoramas... comme point de départ, ou du moins comme source d'inspiration.
Certes, nous ne pouvons ni ne voulons éviter l'attraction fatale de la diversité. Mais qu'entendons-nous exactement par ce terme ? Plus précisément, comment appliquer le stock de connaissances anthropologiques pour comprendre les "anthropologies globales" ? La diversité se manifeste dans les auteurs, les dénominations, mais aussi dans les problèmes ou les objets anthropologiques, les concepts, les lignes théoriques, les traditions, les dynamiques institutionnelles, les lieux, les systèmes de diffusion et de communication à l'intérieur de ces pays. C'est tout ce qui contribue à ce que Roberto Cardoso de Oliveira a appelé les "styles" et qui ne nous limite pas à être, ni à nous comporter, ni à nous concevoir comme de simples répliques périphériques des anthropologies du centre (Cardoso de Oliveira et Ruben, 1995).
Cependant, la diversité est plus que ce que chaque anthropologie nationale possède et produit (pour le marché mondial de la connaissance anthropologique et sa cosmopolitique). C'est aussi ses "veines ouvertes", comme l'a dit Eduardo Galeano, avec toutes ses blessures. Les guerres, les persécutions, les catastrophes "naturelles", la destruction de l'environnement, les révolutions et les dictatures façonnent les peuples et sont façonnés par eux. Elles façonnent aussi leurs anthropologies, comme la révolution mexicaine, le stalinisme, la guerre du Pacifique, la guerre du Golfe, la guerre d'Indochine, etc. l'apartheid. Les blessures historiques sont de véritables sages-femmes des traditions anthropologiques, des alignements académiques et des luttes institutionnelles... par le biais de l'écrit, de la diatribe et du coup d'État, de la purge et de l'exil. Et parce qu'elles sont si endurées et affrontées, c'est-à-dire si attachantes, elles génèrent également des problèmes de connaissance intéressants et sincères.
Dans cette perspective de Panoramas il existe d'autres diversités. Il y a d'abord ce que l'on pourrait appeler les "joyaux des anthropologies nationales", c'est-à-dire leurs personnalités vénérées, certaines tombées en disgrâce, d'autres maudites et justifiées, certaines phares, d'autres apocryphes, celles qui ont été vaincues et celles qui sont encore en vigueur. Comment et pourquoi ont-elles connu l'ascension et la chute ? Quels ont été leurs réseaux, leurs rampes de lancement, leurs alliances nationales et internationales, leurs relations académiques et politiques ? Quels ont été leurs champs ethnographiques, leurs notions privilégiées, leurs principaux travaux, leurs cadres dans les différentes branches de l'anthropologie ? En vertu de quelles approches, internes ou externes, ont-ils été mis en débat ? Comment les constructions institutionnelles et les factions étatiques sont-elles intervenues dans leurs trajectoires bien ou mal acquises ?
Une autre diversité est la thématique, inscrite dans les agendas anthropologiques nationaux, régionaux et internationaux. Il y a des questions qui sont emballées dans les anthropologies de l'Atlantique Nord, mais il y en a d'autres qui sont le résultat de préoccupations culturelles, politiques et humanitaires plus limitées ou qui sont le résultat de l'appropriation et de la nativisation d'agendas métropolitains, de l'époque et de la situation actuelle. Féminisme, droits de l'homme, désertification et racisme, ethnosLes droits autochtones n'ont pas la même signification et ne sont pas non plus pratiqués de la même manière dans les différents pays et à travers les âges.
Une autre diversité intéressante montrée dans ces chapitres est si évidente qu'elle nous est souvent invisible : la relation entre nos anthropologies et nos États (nationaux, départementaux, provinciaux et locaux). Nous pourrions inclure ici la manière dont les anthropologies sont affectées par les changements d'orientation des partis - comme dans l'Europe de l'Est socialiste -, par les changements de régime - démocratique, autoritaire - et par les changements de gouvernement. Nous pourrions également examiner quels agendas anthropologiques correspondent, sont développés ou avortés par les agendas de nos Etats, et comment nos champs anthropologiques, nos théories, nos pratiques et nos problèmes s'y rapportent.
Les auteurs de chaque chapitre, des collègues qui sont généralement devenus anthropologues dans les pays sur lesquels ils écrivent, font preuve d'une autre diversité. Chacun a des modèles d'historicisation différents (temps, causalité, signification), des critères différents pour justifier la sélection des personnalités les plus pertinentes et pour caractériser les particularités de leur(s) anthropologie(s) nationale(s) et infranationale(s). Dans ce contexte, il est important de rassembler les façons dont les auteurs décrivent et, par conséquent, expliquent leurs propres histoires disciplinaires, quels sont les alignements politiques et académiques et quels sont les prétendants les plus obstinés.
Panorama des anthropologies mondiales Il nous permet de sortir de l'Atlantique Nord-centrisme et nous inscrit dans les processus plus généraux de nos réalités socioculturelles et politico-économiques, ainsi que dans les cycles biographiques et d'auteur de nos collègues ; il nous aide à apprendre comment, dans d'autres contextes, différents problèmes de connaissance et de survie qui nous affectent aujourd'hui ont été résolus ou au moins affrontés (la boîte à outils !); il nous permet d'analyser la relation entre nos anthropologies et les vicissitudes historiques, mais non pas comme des déterminations mais comme des possibilités dans les dialogues d'effets multiples dans les sélections thématiques, dans les profils professionnels, dans les avatars historiques.) ; elle nous permet d'analyser la relation entre nos anthropologies et les vicissitudes historiques, non pas comme des déterminations, mais comme des possibilités dans les dialogues d'effets multiples dans les sélections thématiques, dans les profils professionnels, dans les élaborations théoriques, dans les pratiques de terrain, dans les formulations de chaque constat et, bien sûr, dans les chemins que suivent nos productions. Elle nous amène aussi à visualiser comment nos anthropologies sont organisées et comment elles sont classées en interne et par rapport à d'autres anthropologies et d'autres disciplines. Mais surtout, elle nous pousse à comprendre comment nous pensons et faisons des "anthropologies de chair et de sang" dans nos pays, avec nos enjeux politiques, avec nos ressources matérielles et immatérielles.
En bref, Panorama des anthropologies mondiales s'offre à nous comme une carrière prête à être explorée selon la pratique incontournable de notre discipline : la comparaison. Et ce n'est pas seulement avec les pays immédiatement voisins, ni avec les pays d'influence anthropologique globale ; c'est aussi avec les anthropologies des autres sections de ce livre. Ainsi, dans le passage de ce que les anthropologies ont en commun à ce qui les distingue, nous pourrions rejoindre notre mondialisation avec un savoir plus authentiquement universel (Peirano, 1995) et moins centré sur l'Atlantique Nord.
Plus que des histoires, raccontos, comptes, recueils, chronologies, dénombrements, entrées nationales, régionales et infranationales de Panoramas sont une invitation à un exercice anthropologique sur les anthropologies, un miroir reflétant une image unique et multiple, peuplé d'accents, de couleurs et d'environnements différents, certains ignorés, la plupart inattendus, tous magnifiquement accueillis.
Bibliographie
Amid Talai, Vered (ed.) (2004). Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology. Londres/Nueva York: Routledge.
Bonte, Pierre y Michel Izard (dirs.) [1991] (2013). Dictionnaire d’ethnologie et anthropologie. París: puf.
Boscovich, Aleksandar (ed.) (2008). Other People’s Anthropologies. Ethnographic Practice on the Margins. Nueva York: Berghahn Books.
Callan, Hilary (ed.) (2018). International Encyclopaedia of Anthropology. Nueva York: Wiley & Sons. 12 vols.
Cardoso de Oliveira y Guilhermo Ruben (orgs.) (1995). Estilos da antropología. Campinas: Unicamp.
Didier, Béatrice; Antoinette Fouque y Mireille Calle-Gruber (dirs.) (2013). Le Dictionnaire Universel des Créatrices. París: Édition des Femmes. 3 vols.
Lins Ribeiro, Gustavo y Arturo Escobar (eds.) (2006). World Anthropologies. Disciplinary Transformations within Systems of Power. Londres/Nueva York: Berg Publishers.
Peirano, Mariza (1995). A favor da etnografía. Río de Janeiro: Relumé Dumara.
Poole, Deborah (ed.) (2008). A Companion to Latin American Anthropology. Oxford: Blackwell.
Rosana Guber est titulaire d'un doctorat en anthropologie sociale et est chercheur principal. conicetArgentine. Recherche anthropologique sur les anthropologies argentines, la guerre des Malouines (1982) et la méthode ethnographique. Elle est l'auteur de Le sauvage métropolitain (1991), Ethnographie : méthode, terrain et réflexivité (2001), Des garçons aux vétérans (2004), Articulation ethnographique (2013), Expérience du faucon (2016), ainsi qu'organisateur et auteur des volumes Travail sur le terrain en Amérique latine (2018), Mer de guerre (2022) et, avec Lía Ferrero, de Anthropologies made in Argentina (2021-2022). Il dirige le master en anthropologie sociale. ides-eidaes/unsamet codirige le diplôme international en théories anthropologiques de l'Amérique latine et des Caraïbes (Diplomatura Internacional en Teorías Antropológicas de América Latina y el Caribe).ditalc) de l'Université Alberto Hurtado au Chili et la eidaes/unsamArgentine.




