La charnière du phénomène religieux : la diversité du sacré dans le Mexique contemporain
- María Fernanda Apipilhuasco Miranda
- ― voir biodata
La charnière du phénomène religieux : la diversité du sacré dans le Mexique contemporain
Réception : 27 août 2024
Acceptation : 30 octobre 2024
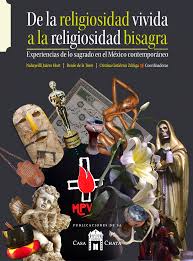
De la religiosité vécue à la religiosité charnière. Expériences du sacré dans le Mexique contemporain.
Nahayeilli Juárez Huet, Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga (coordinatrices)Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2023, Mexico, 809 pp.
Je suis reconnaissant au programme de bourses postdoctorales de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA). unamet à mon conseiller, le Dr David de Ángel García, pour son soutien.
De la religiosité vécue à la religiosité charnière. Expériences du sacré dans le Mexique contemporain. Nahayeilli Juárez Huet, Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga (coordinateurs). Mexico : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2023, 809 pp. isbn: 978-607-486-677-3
Dans le livre De la religiosité vécue à la religiosité charnièreD. et les coordinatrices Nahayeilli Juárez, Renée de la Torre et Cristina Gutiérrez partagent avec nous une recherche de longue haleine - d'envergure nationale et de dimension plurielle - sur la subjectivité de la vie religieuse et sa diversité dans le Mexique contemporain, dans laquelle des éléments quantitatifs et des méthodes qualitatives sont utilisés pour fournir une analyse puissante afin de comprendre la pluralité religieuse à travers deux concepts et méthodologies clés : la religiosité vécue et la religiosité charnière. Ceux-ci sont également appliqués et analysés par 21 chercheurs - spécialisés dans différentes religions - dont les travaux, associés à ceux des coordinateurs, constituent le corps de l'ouvrage.
Le livre dans son ensemble interpelle le lecteur à bien des égards, qu'il s'agisse de la sphère existentielle (qui prend en compte la homo religiosus D'une part, en tant que chercheurs, en ce qui concerne leurs propres méthodologies, leurs relations avec leurs interlocuteurs et leur voix dans le travail ethnographique ; d'autre part, en tant que proposition pertinente dans les études religieuses - principalement sociologiques et anthropologiques - qui met sur la table le débat des sciences sociales sur la structure et l'agence.
Compte tenu de la complexité et de la longueur du texte, cette analyse est divisée en trois sections : la première section présente la proposition générale des coordinateurs ; la deuxième présente la manière dont le livre s'articule à travers ses 27 chapitres ; et enfin, la troisième section présente certaines résonances de la proposition théorique de la charnière par rapport aux concepts d'inspiration latourienne tels que le nœud et l'incertitude ontologique.
Une recherche extraordinaire
D'une manière générale, cet ouvrage est le résultat des travaux de recherche effectués par les coordinateurs.1 Depuis 2017, ils étudient la diversité religieuse au Mexique à partir de sources quantitatives telles que les recensements de l'Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique (inegi), et l'enquête nationale sur les croyances et pratiques religieuses (Encreer, 2016), sur la base desquels ils exposent la reconfiguration du champ religieux au Mexique comme un processus lent mais soutenu (p. 21). Leur intérêt est de rendre compte des "différentes façons de vivre la religiosité au Mexique, où la religiosité est diverse et représente des cadres de différenciation culturelle" (p. 21). L'un des objectifs est de contribuer à une culture d'acceptation, d'appréciation et de respect de l'altérité religieuse (p. 21).
Les coordinateurs souhaitent savoir comment les gens vivent leur religiosité et le sacré, à partir de la vie quotidienne et de la matérialité, comment ils la construisent à partir de différentes logiques culturelles et religieuses, et les décisions qu'ils prennent à partir de leur histoire biographique et en tant que sujets situés par rapport à la classe sociale, au sexe et à la tranche d'âge, entre autres. Ils mettent donc l'accent sur l'expérience du sujet qui se trouve dans le cadre ou en marge de la religion en termes d'institution, mais qui ne la détermine pas. Ici, la structure ou le système religieux n'agit pas comme un cadre interprétatif de l'action des acteurs religieux, mais permet plutôt à ces derniers de guider et de montrer les multiples façons de construire le religieux à partir de leur expérience de vie (carrefours, crises, adversités, positions politiques, dissidence, critique, entre autres) et comment cela n'est pas vécu dans l'abstrait mais à partir de la matérialité (objets, lieux, espaces, le corps, les prières, les prières, entre autres). Cette proposition n'implique pas d'individualiser l'analyse et de la laisser comme des cas isolés, mais de situer les histoires des sujets dans leur contexte social plus large (p. 719).
Les coordinateurs discutent de la manière dont le phénomène religieux est habituellement étudié, principalement dans une perspective institutionnelle et de recensement, et proposent une méthodologie phénoménologique basée sur le concept de religion quotidienne ou religion vécue, qui prend en compte la manière dont les sujets construisent leurs cadres d'interprétation de l'être et du monde à partir de leur religiosité. Ces cadres n'émergent pas de nulle part, mais d'un contexte social qui implique la position de l'individu en termes familiaux, de voisinage, locaux et nationaux.
Ainsi, la réflexivité des sujets, leurs conditions, possibilités et dynamisme dans le champ religieux (mobilités religieuses) qui génèrent des appartenances et des identités dynamiques, des positionnements politiques (féminismes ou pratiques environnementales) et des modes de subsistance économique tout au long de la vie sont mis en évidence.
L'engrenage
Juárez, De la Torre et Gutiérrez ont réuni un groupe de chercheurs spécialisés dans les différentes religions et religiosités au Mexique afin d'utiliser explicitement la méthodologie de la religiosité vécue. Ce groupe s'est concentré sur la mise en œuvre d'un guide d'entretien et l'enregistrement des matérialités (inclus dans les annexes du livre), que chacun a complété par d'autres outils ethnographiques. Bien qu'ils aient eu une ligne directrice très marquée : l'entretien et l'analyse, ainsi que les discussions collectives, chaque auteur a imprimé sa propre marque au travail ; certains avaient une relation antérieure de plusieurs années avec les personnes interrogées, ce qui est évident dans la profondeur de leur analyse, comme le travail de David de Ángel, Gabriela Gil, Antonio Higuera et Cristina Mazariegos. Ainsi, on trouve des descriptions riches qui placent le lecteur dans l'espace de l'entretien, et des descriptions des personnes interrogées qui donnent la chair de poule en ce qui concerne leurs expériences et leurs sentiments. Il y a aussi des voix qui ne sont pas si convaincues de la méthodologie, mais qui exposent ses possibilités et ses limites, et celles qui s'interrogent même sur les questions et les observations qu'elles élaborent à partir d'une ontologie logocentrique, épistémocentrique ou occidentale, comme c'est le cas de Cristina Gutiérrez et de Gabriela Gil. Dans les chapitres, nous pouvons trouver l'expertise des auteurs en ce qui concerne le système religieux dans lequel les acteurs sont dessinés ou estompés. Il est très important de souligner que chaque chercheur expose ce qu'il entend par matérialité, en la thématisant dans certains cas à partir de latitudes telles que les ontologies, les diverses manières d'être des objets et leurs relations avec les humains (voir Renée de la Torre, Gabriela Gil, Olga Lidia Olivas, Cristina Gutiérrez, Arely Medina et Adrián Yllescas).
La structure de l'ouvrage tient compte de deux éléments clés : les tendances statistiques sur la recomposition du champ religieux au Mexique et la manière dont cette recomposition est vécue dans la vie quotidienne des gens (p. 22). Les cas présentés ont donc été choisis de manière à représenter la diversité religieuse actuelle et à illustrer les différentes régions et variables sociodémographiques - âge, appartenance ethnique, sexe, niveau socio-économique et niveau d'éducation (p. 22). Le livre se compose donc d'une introduction générale, de 27 chapitres et de conclusions générales. Dès la première page, on constate le soin apporté par les coordinateurs en termes de rigueur, de dialogue avec les auteurs des chapitres et, surtout, de prise en compte de la voix des interlocuteurs.
Le livre est divisé en trois sections dont les objectifs sont de rendre compte de la diversité religieuse, même au sein de religions apparemment bien délimitées et structurées telles que le catholicisme et les évangéliques ou les chrétiens. La première section, "Catholiques" - sept chapitres - a été coordonnée et introduite par Cristina Gutiérrez. Elle rend compte de la diversité régionale et ethnique du catholicisme mexicain, religion actuellement professée par 77% de la population selon le recensement de 2020 (p. 64). L'accent est mis sur la démonstration de la différenciation interne du catholicisme, qui implique un modèle de régionalisation basé sur sa configuration historique et sa diversité ethnique à partir des groupes indigènes en termes de syncrétisme (p. 64 et 65). Ainsi, on peut lire les témoignages d'une catholique critique et libératrice de Cuernavaca, Morelos (Cecilia Delgado-Molina), d'une " fille ibérique " de l'Opus Dei de Mexico (Gabriela García), d'une jeune catholique de Guadalajara, Jalisco (Anel Victoria Salas), d'une catholique non pratiquante de Guadalajara, Jalisco (Renée de la Torre de la Torre), d'une jeune catholique de Guadalajara, Jalisco (Anel Victoria Salas), et d'une catholique non pratiquante de Guadalajara, Jalisco (Renée de la Torre), Jalisco (Renée de la Torre), un catholique maya de Nunkiní, Campeche (David de Ángel García), un Rarámuri catholique avec ses coutumes traditionnelles du haut Tarahumara à Chihuahua (Gabriela Gil), et l'expérience charismatique d'une migrante Tseltal à San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Gabriela Robledo).
La deuxième section correspond aux "Chrétiens" - avec neuf chapitres -, coordonnés et introduits par Renée de la Torre, dans lesquels il est rendu compte de la pluralité des chrétiens ou évangéliques qui représentent aujourd'hui 11,2% de la population mexicaine (inegi 2020). Il est montré ici comment les particularités des cas génèrent des cultures qui exigent des adaptations religieuses, dont les trajectoires de mobilité religieuse multiple impliquent des négociations, des articulations et des intégrations constantes (p. 248). Il convient également de noter l'approche de la matérialité dans la vie quotidienne des interlocuteurs, qui passe des objets sacrés conventionnels au corps, aux espaces domestiques ou intimes et à la prière, entre autres. Les expériences sont celles d'une femme méthodiste-féministe de Guanajuato (Hilda María Cristina Mazariegos), d'un presbytérien de Xalapa, Veracruz, qui vit sa religion en toute liberté (Felipe R. Vázquez), d'un pentecôtiste de Ciudad Juárez (Patricio Vázquez), d'un pentecôtiste tojolabal du Chiapas (Enriqueta Lerma), d'un jeune évangélique-pentecôtiste de Tijuana, Basse-Californie (Carlos S. Ibarra), une homosexuelle d'identité évangélique dissidente de Mexico (Karina Bárcenas), une femme adventiste de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Minerva Yoimy Castañeda), un témoin de Jéhovah immigré de Chetumal, Quintana Roo (Antonio Higuera), et une femme mormone d'Aguascalientes (Genaro Zalpa).
La dernière section s'intitule "Sin religión y religiones minoritarias" - avec onze chapitres -, coordonnée et introduite par Nahayeilli Juárez, qui englobe les expériences des personnes désaffiliées et non affiliées qui n'appartiennent explicitement à aucune institution religieuse ou ecclésiastique (p. 453) ; dans une seule section, elle regroupe des personnes ayant leur propre chemin spirituel (p. 454), et des personnes appartenant à des religions minoritaires dans le pays. Ainsi, dans cette section, on trouve une prêtresse tantrique de Mexico (María del Rosario Ramírez), un docteur spirituel autoproclamé en littérature avec une cosmovision wixárika de Guadalajara, Jalisco (Renée de la Torre), une adepte de Krishnamurti à Guadalajara, Jalisco (Cristina Gutiérrez), une laïque zen à Mérida, Yucatán (Nahaye de la Torre), et une laïque zen à Mérida, Yucatán (Nahaye de la Torre), qui est une adepte de Krishnamurti à Guadalajara, Jalisco (Cristina Gutiérrez), Yucatán (Nahayeilli Juárez), un pratiquant de la voie mexicaine-lakota à Tijuana, Baja California (Olga Lidia Olivas), un franc-maçon homosexuel à Aguascalientes (María Eugenia Patiño), un musulman à Guadalajara, Jalisco (Arely Medina), un juif à Guadalajara, Jalisco (Cristina Gutiérrez), un spirite marial trinitaire à Veracruz (Gabriela Castillo), un santero et une femme de la rue de la ville de Mérida, Yucatán (Cristina Gutiérrez). entraîneur à Mérida, dans le Yucatán (Nahayeilli Juárez), et un adepte de la Santa Muerte à Mexico (Adrián Yllescas).
Il est important de souligner que le livre dans son ensemble et la méthodologie employée prennent au sérieux la parole, la sensation et la matérialité de l'autre (avec d'ailleurs de belles photographies soigneusement choisies), en un seul terme : son expérience du monde, sans la limiter, la classer ou la simplifier, mais plutôt en tenant compte de sa portée, de ses limites, de ses complexités et, surtout, de la réflexivité de sujets dotés d'une agence, capables de décider et d'interpréter - dans des cadres déterminés - leur être et leur agir.
Nous trouvons ainsi des agents qui communiquent leur besoin de croire en quelque chose, ou en quelqu'un, de manière réflexive et critique, ainsi que la matérialisation de leurs croyances, leurs transitions entre différentes religions, leurs constructions sur le sacré, le corps, la famille, la personne, le genre, la mort et le sens de leur existence à travers la sacralisation ou la contemplation de leur vie quotidienne et de leur lien avec les autres et avec l'environnement. Cela est perçu de manière diverse et hétérogène, mais comme une constante dans tous les chapitres.
Dans les conclusions de l'ouvrage, les coordinateurs comparent et analysent l'ensemble des chapitres et partagent leur apport théorico-méthodologique : la religiosité charnière, à partir d'une approche phénoménologique et matérialiste, qui implique de comprendre le phénomène religieux à partir de l'expérience concrète située comme un processus et non comme des classifications préconçues (p. 723), qui n'est pas seulement due à une logique religieuse institutionnalisée, mais à l'assemblage que chaque sujet réalise à partir de son expérience de vie. La religiosité charnière est donc une perspective relationnelle, une articulation d'ancrage et de dynamisme, qui sont
points d'articulation où les attentes individuelles sont négociées avec le système de normes et de valeurs institutionnelles, l'adéquation des changements aux traditions et la validité de la foi dans les sphères séculières [...] offre la possibilité d'imaginer des concepts fondés non pas sur des oppositions mais sur des intersections et des complémentarités mises en mouvement par la religiosité quotidienne (p. 726).
Ainsi, selon cette approche, le phénomène religieux peut être compris comme un concept polyphonique composé de différentes mélodies, allant de l'expérience réflexive des individus aux normes institutionnelles.
Résonance
Enfin, la contribution théorico-phénoménologique des coordinateurs au domaine religieux fait écho à certains éléments de perspectives pragmatiques telles que la Théorie de l'acteur-réseau (goudron). Les coordinateurs passent de la religiosité vécue à la charnière, brouillant les classifications et les notions apparemment dichotomiques ou binaires, et plaçant la matérialité au centre de leur analyse. L'utilité de la charnière réside dans le fait de "nommer les processus interstitiels qui articulent différentes traditions religieuses et qui se produisent simultanément dans le même événement" (p. 728) ; il s'agit donc d'un point de contact "où différents courants, échelles ou contenus sont articulés et où les charnières fonctionnent comme des ancrages, où les religiosités émergentes interagissent avec les religiosités traditionnelles" (p. 728). Cette mobilité des classifications et des articulations entre en résonance avec deux notions latouriennes qui soulignent la contribution des auteurs.
Le premier est le principe de l'incertitude ontologique qui, dans l'étude des pratiques, implique de ne pas établir d'agence. a prioriL'objectif est d'être guidé par le principe d'incertitude, c'est-à-dire d'avoir un manque de certitude quant aux objectifs dans les interactions sociales afin de suivre l'action de tous les acteurs impliqués. Il n'est donc pas nécessaire d'établir des essences de sujets et d'objets, ni de créer des fixités ou des objectifs autour d'eux (Latour, 1994). Cela coïncide avec les coordinateurs qui considèrent que la religiosité charnière implique des adaptations des sujets - à travers leurs expériences - à la diversité religieuse, de sorte que l'accent est mis sur la dynamique de l'identification et non sur les identités pures ou fermées qui assurent la fixité de la religion en termes institutionnels (p. 732). La seconde est une notion de nœud inspirée de Bruno Latour, comprise comme une articulation où de nombreux ensembles d'agences convergent et agissent simultanément (Apipilhuasco, 2021 : 5). Bien que le nœud pour Latour s'éloigne de la science informatique qui planifie le nœud comme une articulation (cfr. Latour, 2008), il est possible de le repenser en tant que tel, en termes méthodologiques, en se connectant à ce qu'il considère : " l'action doit être comprise comme un nœud, un nœud et un conglomérat de nombreux ensembles surprenants d'agences qui doivent être lentement démêlés " (Latour, 2008 : 70), elle n'a pas de structure définie, pas de caractère stratégique, elle n'est pas fixe et a autant de dimensions que de connexions (Latour, 1996 : 369 et 370). Caractériser l'action, les événements et même la matérialité comme un nœud, c'est y penser métaphoriquement comme un lieu où des connexions sont établies et où transitent divers ensembles d'actions qui ne sont ni fixes ni établies, mais en constant dynamisme, en fonction de tous les acteurs humains et non humains qui y sont impliqués (Apipilhuasco, 2021). La charnière est donc cet espace d'articulation où diverses religions interagissent, "donnant lieu à des produits syncrétiques et hybrides dérivés de biens et de significations religieux" (p. 728).
Ainsi, la charnière, tout comme l'incertitude ontologique et le nœud, peuvent être des notions qui aident à l'investigation du domaine religieux, en tant qu'éléments permettant de générer des méthodologies qui partent d'une perspective émique -L'objectif principal de l'étude est de comprendre la mobilité, la diversité et le dynamisme des identités religieuses dans un contexte social large.
Bibliographie
Apipilhuasco, María Fernanda (2021). “Ñatitas. Producción, agencia y ritualidad de los cráneos en La Paz, Bolivia”. Tesis de doctorado. Zamora: El Colegio de Michoacán.
Latour, Bruno (1994). “On Technical Mediation: Philosophy, Sociology, Genealogy”, Common Knowledge, vol. 3, núm. 2, pp. 29–64. Recuperado de https://philpapers.org/rec/latotm
— (1996). “On Actor-Network Theory: A Few Clarifications”, Soziale Welt, vol. 47, núm. 4, pp. 369-381. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/40878163
— (2008). Reensamblar lo social: una introducción a la Teoría del Actor-Red. Buenos Aires: Manantial.
María Fernanda Apipilhuasco Miranda Il est titulaire d'un doctorat en anthropologie sociale du El Colegio de Michoacán et d'un diplôme en sociologie de la faculté des sciences politiques et sociales de l'université de Michoacán. unam. Il a mené des projets de recherche à Janitzio (Michoacán), La Paz (Bolivie) et Pomuch (Campeche). Ses thèmes de recherche sont la sociologie et l'anthropologie de la religion, le mythe, l'anthropologie de la mort, l'indigénéité, la patrimonialisation et les ontologies des Andes centrales. Elle effectue actuellement sa deuxième année de séjour postdoctoral au Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de l'Universidad Nacional Autónoma de México.




